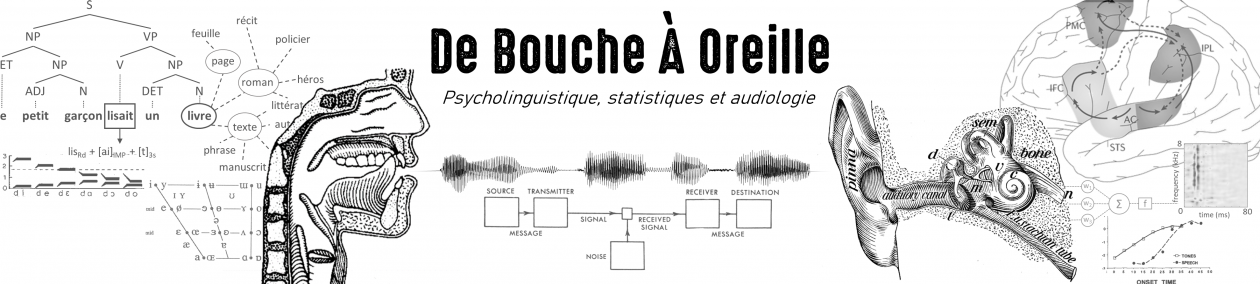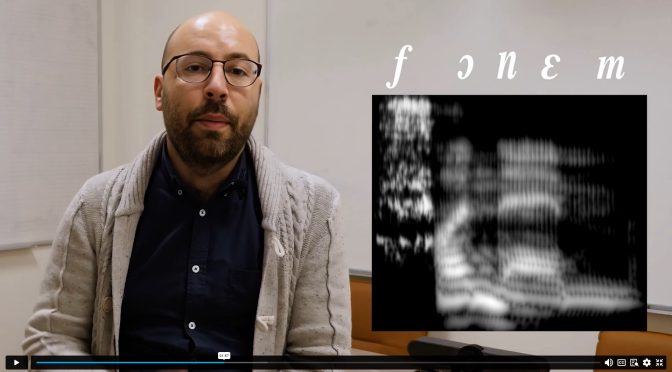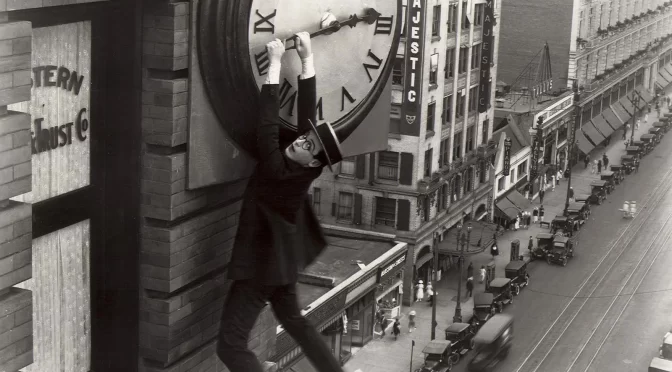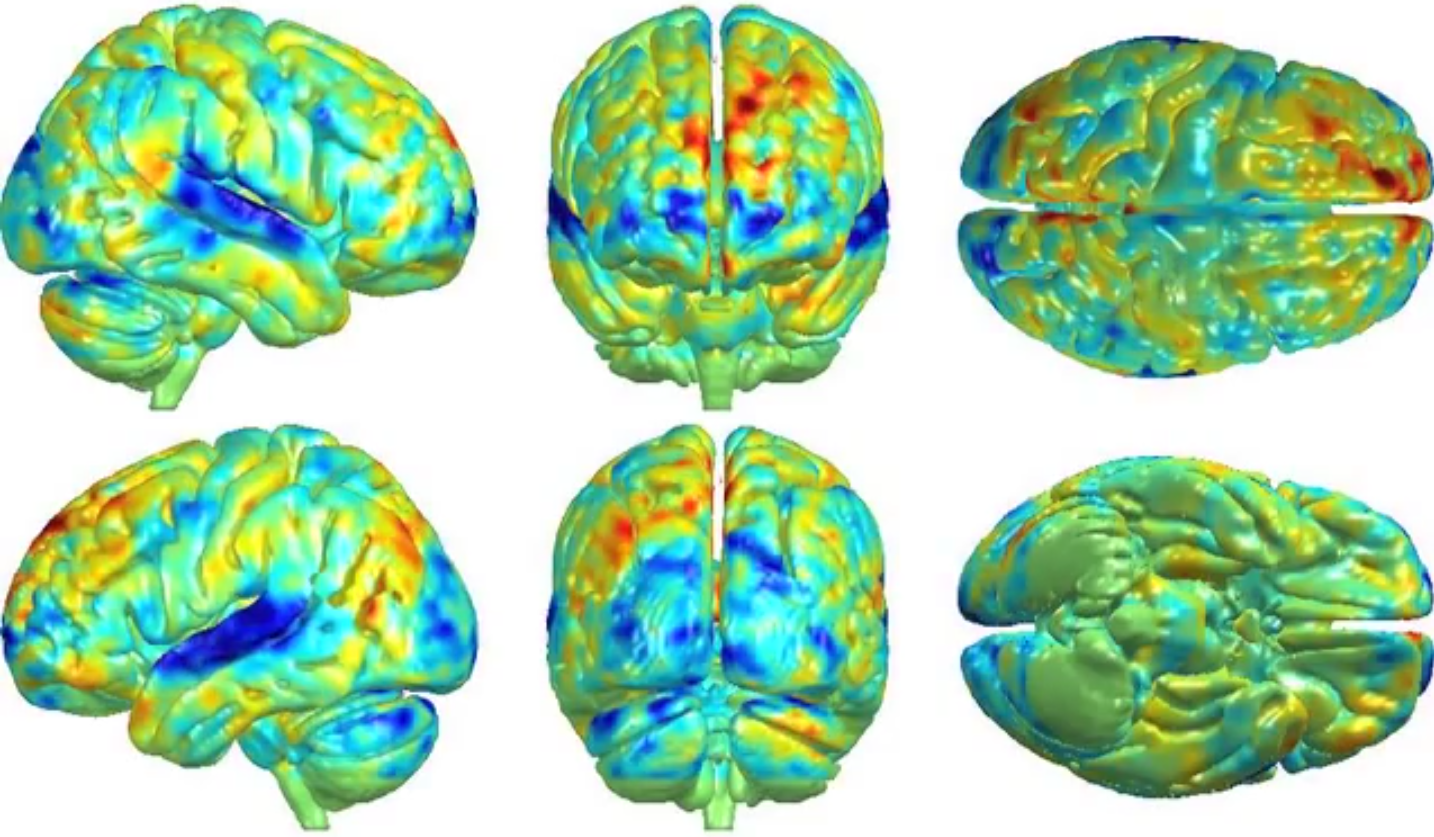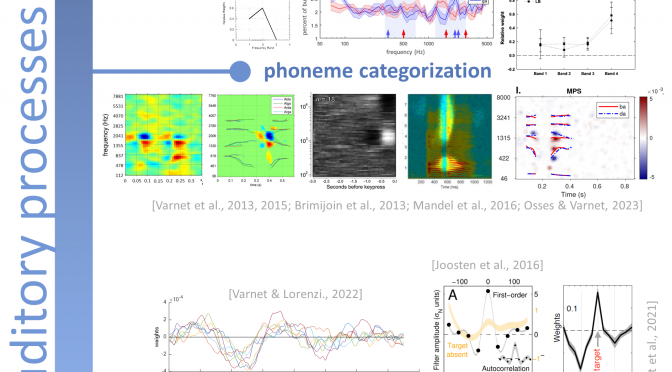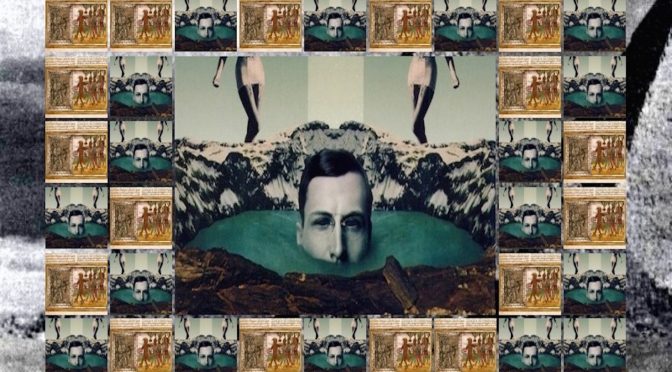« Le monde universitaire n’était pas moins normé [dans les années 70] qu’il ne l’est actuellement. Des thèses poursuivies des années durant. Des professeurs gérant à vie des domaines réservés. Des recteurs, des doyens, des présidents, réactionnaires et idiots, des politiques incultes, des ministres flics, des Grandes Écoles arrogantes et archaïques, des concours contre-sélectifs, etc. On avait tout ça aussi bien que maintenant. Alors, quelle différence ? Peut-être une différence dans les modes de contrôle et de gestion. Les techniques du management moderne n’avaient pas encore pénétré le monde de l’Université et de la culture. Le pouvoir se manifestait de façon autoritaire, mais il manquait de moyens pour aller plus loin et pour y voir clair. Un peu partout existaient des recoins mal gérés ou oubliés, des institutions endormies dont on pouvait détourner les ressources, des zones, des marges, à l’écart de la concurrence, dans lesquelles il était possible de s’enraciner pour faire ce que l’on voulait et parfois du nouveau. Rien n’était juste, au moins si l’on prend ce terme dans son sens méritocratique. Rien n’était correctement évalué. Avec le même salaire, certains faisaient une œuvre et d’autres rien. Avec la même dotation, certains labos faisaient l’impossible et d’autres ronronnaient doucement. Mais ce laisser aller, cette négligence gestionnaire était précisément ce qui ouvrait un espace de liberté où la création devenait possible. »
(Luc Boltanski, Rendre la réalité inacceptable)
Depuis le 16 octobre dernier, j’utilise une application pour comptabiliser le temps que je consacre à chaque tâche dans mon activité de Chargé de Recherche CNRS. Je souhaitais en particulier quantifier la proportion des tâches administratives dans mon emploi du temps : comme beaucoup de personnes au sein de l’ESR, le management de la recherche me semble entraîner une perte de temps colossale. Alors que je m’apprête à partir en congé paternité, il est l’heure de tirer un premier bilan provisoire.
Continuer la lecture de Poids des tâches administratives dans le temps de recherche →