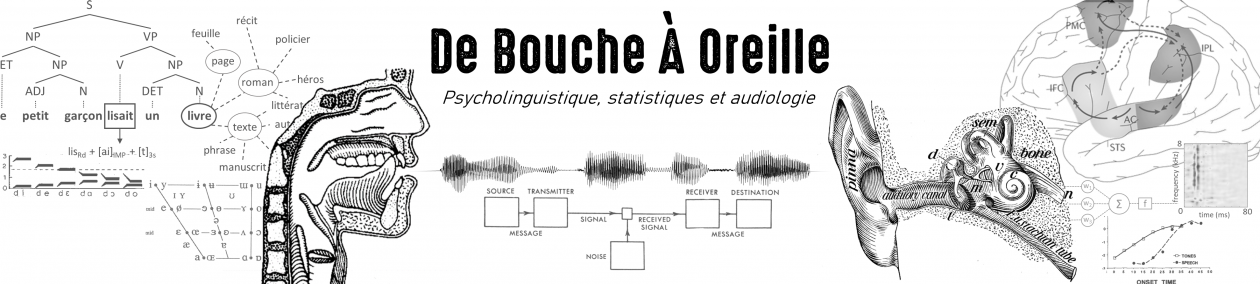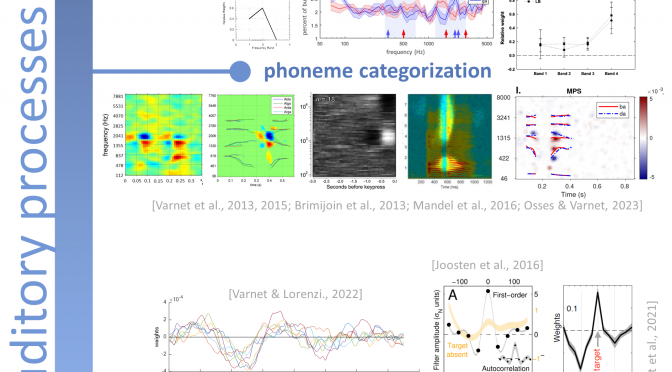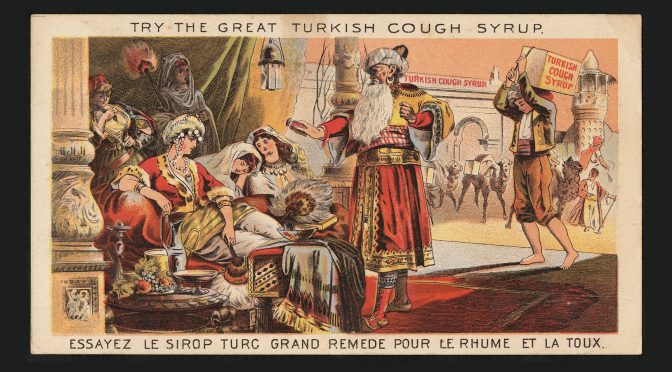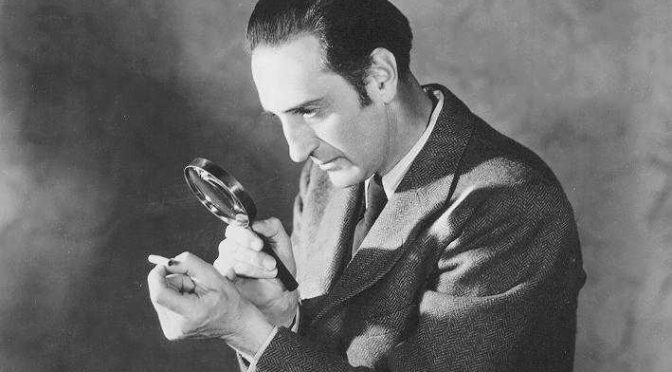Au fil de l’histoire du cinéma, et même avant l’avènement du parlant, la voix humaine a été une source inépuisable d’inspiration pour les réalisateurs et réalisatrices, en particulier dans son lien avec la notion d’identité [1], [2]. Sans prétention à une analyse théorique détaillée qui dépasserait mon champ de compétence, j’aimerais ici évoquer le rôle symbolique de la voix à l’écran, notamment comme marqueur de l’identité réelle du locuteur ou de la locutrice. J’illustrerai mon argumentation au moyen d’exemples familiers issus du cinéma fantastique occidental – et essentiellement hollywoodien – genre cinématographique obsédé par les thèmes de l’identité, de la métamorphose et de la possession.
Continuer la lecture de Voix, métamorphoses et possessions au cinéma